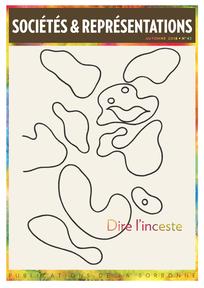
Dire l’inceste : De la parole de Violette Nozière au discours de l’historien (1933-2015)
Fiche mise à jour le 14 mai 2021
En bref
Description
Dire l’inceste
Résumé :Cet article envisage l’affaire Nozière comme un moment où, dans le cadre d’une procédure judiciaire pour parricide, une parole sur l’inceste a été tenue. Cette parole, que peut en dire l’historien et que lui apprend-t-elle ? Comment peut-il en faire un objet d’histoire ? Comment doit-il l’aborder et quelles questions doit-il se poser ? Reprenant le dossier d’une affaire judiciaire fameuse des années trente, cet article montre d’abord, à travers une étude des représentations de l’inceste, des auteurs ainsi que des victimes des violences sexuelles, la force du tabou qui a frappé la parole sur l’inceste, objet d’une occultation judiciaire et sociale durable. À travers une réflexion épistémologique, méthodologique et déontologique, il discute ensuite la position de l’historien face à la parole sur l’inceste : l’historien doit-il, dans cette affaire, cantonner son étude aux représentations et à la réception de la parole sur l’inceste ou au contraire doit-il envisager l’inceste comme un fait en se demandant si Violette Nozière a dit vrai ? L’article soutient que la réalité ou non de l’inceste est une question historique légitime et que refuser de la poser, c’est risquer de répondre à l’interdit du dire social par l’interdit du dire historique et d’abriter le tabou derrière des positions scientifiques.
Sommaire :- Le tabou ou comment ne pas entendre l’indicible
- L’inceste, du dire au fait
Procédure judiciaire, Histoire, 20e siècle, Représentation sociale, Interdit


